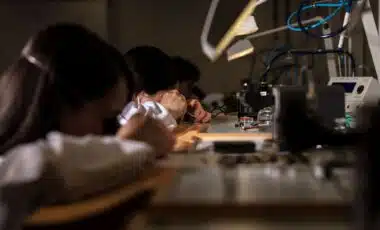Les cantons romands, soutenus par la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO), ont adressé une lettre à la Commission de l’économie du Conseil national pour lui demander de ne pas entrer en matière sur ce projet. Cette intervention intervient alors que la Commission s’est saisie du dossier en ce début de semaine.
Le débat prend racine dans une motion adoptée en 2022 par le Parlement. Portée par le centriste Erich Ettlin (Le Centre/OW), elle prévoit que les conventions collectives de travail (CCT) étendues priment sur les lois cantonales, même si ces dernières instaurent un salaire minimum voté démocratiquement.
Une volonté populaire remise en cause
Cinq cantons appliquent déjà un salaire minimum légal : Genève, Neuchâtel, le Jura, Bâle-Ville et le Tessin. À ces territoires s’ajoutent deux initiatives vaudoises ayant abouti, réclamant un plancher horaire à 23 francs, ainsi qu’une initiative récemment déposée dans le canton de Fribourg. À Genève, ce salaire s’élève actuellement à 24,48 francs de l’heure, hors agriculture et horticulture. À Neuchâtel, il atteint 21,31 francs, également hors secteur agricole.
Le projet fédéral remettrait en cause ces dispositions. À Genève et Neuchâtel notamment, plusieurs branches seraient directement concernées, selon le syndicat Unia. Seraient touchés les secteurs de la coiffure, de l’hôtellerie-restauration, de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale, de l’artisanat du métal, du second œuvre ou encore de l’industrie du meuble. Le risque principal évoqué : une baisse des salaires dans les emplois les plus précaires.
Dans leur courrier, les gouvernements romands qualifient ce projet d’« atteinte à l’autonomie des cantons et au fédéralisme » et affirment qu’il « ignore la volonté des citoyens de Suisse occidentale », comme l’a indiqué la CGSO, confirmant une information parue dans La Tribune de Genève.
Des réactions politiques fermes
La conseillère d’État genevoise Delphine Bachmann, en charge du Département de l’économie et de l’emploi, regrette que la réforme envisagée « empiète sur l’autonomie des cantons » et « ne permet pas de respecter la votation populaire de 2020, lors de laquelle 58 % des Genevois et Genevoises avaient accepté le salaire minimum », rapporte Le Temps.
Sa collègue neuchâteloise Florence Nater y voit une menace sur l’équilibre institutionnel : « Une telle modification créerait un précédent en ouvrant une brèche dans les compétences respectives de différents niveaux de l’État et enverrait un très mauvais signal aux citoyennes et citoyens quant à la considération de leurs droits politiques ».
Le cas du Jura montre une situation plus nuancée : une dérogation à l’application du salaire minimum y est déjà prévue en cas d’existence d’une CCT, ce qui rendrait les effets de la réforme fédérale plus limités dans ce canton. Le Tessin et Bâle-Ville appliquent également cette exception.
Une controverse juridique et politique
Les défenseurs du projet fédéral invoquent la primauté du droit national sur les législations cantonales. Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) considère qu’il s’agit d’« une question de principe juridique ». Il rappelle que l’extension d’une CCT repose sur une procédure complexe, qui se clôt par un arrêté du Conseil fédéral. À ce titre, affirme-t-il, « le droit fédéral l’emporte, y compris sur les constitutions cantonales ».
Pour certains partisans de la réforme, une solution de compromis pourrait s’inspirer du modèle jurassien. Ce dispositif prévoit une dérogation à l’application du salaire minimum si une CCT étendue régit déjà les conditions salariales du secteur concerné.
Mais cette piste ne suffit pas à convaincre les gouvernements romands, qui redoutent que la généralisation de cette approche mine la portée des votes populaires ayant instauré ces seuils minimaux dans plusieurs cantons.