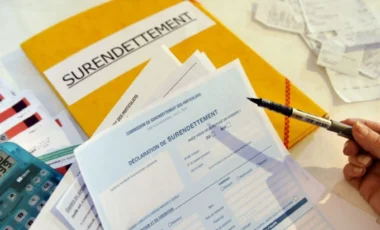Avec la promulgation, le 27 février 2025, de la loi visant à interdire l’usage des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans plusieurs produits de consommation, la France a choisi de précéder le calendrier européen. Une décision saluée dans l’opinion publique pour son ambition sanitaire, mais de plus en plus critiquée dans les milieux économiques et industriels. Car en privilégiant une interdiction rapide, générale et peu différenciée, le législateur a pris le risque de fragiliser des pans entiers du tissu productif français. À rebours de l’objectif affiché de réindustrialisation, cette approche pourrait entraîner des pertes d’emplois, des fermetures de sites et une perte de compétitivité dans des filières stratégiques.
Une loi politiquement efficace, économiquement risquée
La loi, initiée en février 2024 par le député écologiste Nicolas Thierry et définitivement adoptée un an plus tard, prévoit l’interdiction dès 2026 de la fabrication, de l’importation et de la mise sur le marché de nombreux produits contenant des PFAS : cosmétiques, vêtements, chaussures, fart de ski, produits d’hygiène. L’interdiction s’étendra en 2030 à tous les textiles, à l’exception des vêtements de protection des pompiers et des forces de sécurité. Aucun mécanisme d’évaluation toxicologique différenciée n’est prévu dans la loi, ni aucune procédure encadrée de reconnaissance d’« usages essentiels », comme cela est pourtant envisagé au niveau européen dans le cadre du règlement REACH.
Ce choix réglementaire place la France dans une situation d’isolement : elle est à ce jour le seul pays européen à avoir légiféré unilatéralement sur l’ensemble des PFAS, sans attendre les conclusions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). S’il s’agit d’un signal politique fort, cette avance comporte des effets économiques directs, dans un cadre concurrentiel qui reste, lui, européen.
Des filières stratégiques sous pression
L’industrie française utilise les PFAS dans de nombreux domaines à haute valeur ajoutée. Parmi les applications les plus sensibles : les joints haute performance pour l’aéronautique, les membranes pour piles à hydrogène, les câblages ignifugés dans l’automobile, les dispositifs médicaux implantables, ou encore les revêtements anti-adhésifs à base de PTFE. Ce dernier, polymère fluoré à masse moléculaire très élevée, est considéré par les agences sanitaires comme inerte, non soluble, et non bioassimilable. Il est pourtant concerné par la loi française en raison de l’absence de distinction opérée dans le texte.
Dans une vidéo d’enquête diffusée sur YouTube (Une manipulation derrière la loi anti-PFAS ?), le chercheur Bruno Améduri, directeur de recherche au CNRS, rappelle : « Le PTFE est chimiquement inerte, ne migre pas, et n’est pas absorbé par l’organisme. Il n’y a aucun argument scientifique justifiant son interdiction. » Ce point de vue est partagé par plusieurs industriels interrogés dans le même documentaire, qui redoutent une perte de savoir-faire, voire la disparition de certaines productions sur le territoire français.
Téfal, notamment, s’est trouvée ciblée au cours des débats, alors même que son utilisation de PTFE ne concerne que 0,5 % des PFAS présents sur le marché européen. L’usine de Rumilly (Haute-Savoie), qui emploie près d’un millier de personnes, a dû faire face à une campagne de dénigrement publique alors que le produit qu’elle utilise n’est ni classé dangereux ni interdit ailleurs dans l’UE.
Une méthode politique contestée par les acteurs économiques
La publication, le 31 mars 2025, d’une tribune signée par l’ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy dans Le Figaro vient prolonger les critiques adressées à la méthode. Il y dénonce « un Parlement sous influence », ayant voté une loi sans étude d’impact économique, sans concertation scientifique élargie, et sous la pression d’une campagne médiatique orchestrée par une coalition d’ONG, de syndicats et de figures médiatiques.
Dans cette tribune, les auteurs s’interrogent sur l’absence d’expertise technique dans l’élaboration du texte : « Les experts appelant à distinguer les différents types de PFAS […] ont été marginalisés. » Ils rappellent que des chercheurs comme Bruno Améduri n’ont ni été auditionnés, ni publiquement entendus, et que l’argument scientifique s’est trouvé relégué au second plan face à une narration fondée sur la peur et l’urgence.
Pour les industriels, cette méthode crée une instabilité réglementaire préoccupante. Elle envoie un signal négatif à l’investissement productif, d’autant plus problématique que la France affiche simultanément une volonté de réindustrialisation. Les effets immédiats sont déjà perceptibles dans le secteur du textile, où des stocks invendables pourraient coûter des millions d’euros aux entreprises. Dans l’industrie chimique, la fermeture anticipée d’un site dans l’Oise, évoquée dans le documentaire, marque l’un des premiers impacts concrets de la loi.
Un risque d’asphyxie pour l’effort de réindustrialisation
La loi française entre en contradiction avec les objectifs du plan France 2030, qui consacre plus de 50 milliards d’euros à la relocalisation des filières stratégiques, à la transition énergétique et au soutien à l’innovation industrielle. Or, les PFAS sont omniprésents dans les technologies bas carbone — batteries, électrolyseurs, pompes à chaleur, composants électroniques — et dans les solutions médicales de pointe. Une interdiction rapide, sans distinction ni accompagnement, pourrait freiner le déploiement de ces technologies ou pousser les industriels à investir ailleurs.
Le risque est double : voir les sites français perdre en compétitivité par rapport à leurs homologues européens (dont les États appliquent encore le régime REACH standard), ou assister à des transferts de production vers des zones où la régulation est moins contraignante, mais aussi moins écologique. Ce paradoxe — réglementer pour mieux protéger, mais provoquer des délocalisations vers des pays moins-disants — est au cœur des inquiétudes exprimées par les acteurs économiques.
Une interdiction nécessaire, mais à réajuster
Le consensus sur la nécessité d’encadrer les PFAS dangereux n’est pas remis en cause par les industriels. La question n’est pas “faut-il interdire ?”, mais “comment interdire intelligemment ?”. La démarche européenne, bien que plus lente, repose sur une hiérarchisation des risques, l’identification des usages essentiels, et l’évaluation des alternatives. Elle offre un cadre plus stable et scientifiquement fondé, mieux adapté aux cycles industriels longs et aux impératifs d’innovation.
Pour éviter que cette loi ne compromette la dynamique industrielle française, plusieurs experts plaident aujourd’hui pour une révision de sa mise en œuvre. Des dérogations ciblées, un calendrier plus souple, et une cartographie fine des usages à préserver pourraient permettre de retrouver un équilibre entre ambition sanitaire et sécurité économique. Sans cet ajustement, la loi anti-PFAS risque de devenir le symbole d’une bonne intention mal traduite, dont les premiers à payer le prix seront les territoires industriels et les emplois qu’ils portent.